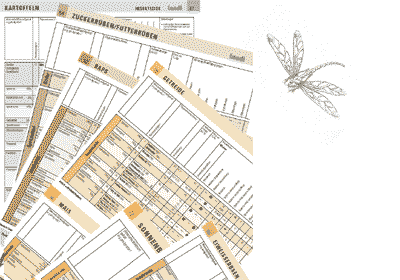Nos cultures grandissent dans une sauce de pesticides maximales qu’elles sont tout juste encore capable de supporter.
Mais trop souvent pas les consommateurs?
De plus en plus, même les cultures ne les supportent plus
Le conte de fées des variétés à haut rendement trop sensibles
« Nous avons besoin de pesticides parce que les variétés modernes produisent des rendements élevés mais elles sont bien plus sensibles que les variétés anciennes et rustiques de nos ancêtres ? »
Nos cultures arables sont (presque toujours) des géants très robustes.
Avec de bonnes pratiques agricoles, les dégâts sont minimes, les insecticides et les fongicides sont inutiles, et les herbicides peuvent être remplacés par des tracteurs et des outils.
Les pesticides sont des produits superflu mais extrêmement lucratif d’un détournement dévastateur.

Le malade imaginaire
Le blé est généralement traité de manière préventive avec des fongicides Azol qui sont soupçonnés de provoquer le cancer.
Même s’il n’y a qu’un seul type de blé qui moisit: Le blé du semis direct au glyphosate.
Il ne toléré pas les quantités record de glyphosate ? Seulement s’il est cultivé après le maïs, et si, pour aggraver les choses, il s’agit d’une des tres rares variétés sensibles à la moisissure.
Alors pourquoi des applications préventives de fongicides ? La recherche agricole gouvernementale les légitime par une seule citation erronée : » Les années d’épidémie, des pertes de rendement de 20 à 30% peuvent survenir » (1). Et l’ « oubli » du titre de cette publication: « Seules les variétés résistantes aident contre les fusarioses auriculaires ». Grâce à cette expertise ancienne, le croisement avec une variété de blé résistante fit disparaitre les variétés sensibles de l’époque et leurs moisissures.
« Avant de semer, faites bien mariner les graines dans une sauce de moisissure »
Ce ne sont pas les paysans qui auraient de tels idées.
Mais bien la recherche agricole gouvernementale : Dans presque toutes leurs expérimentations de fongicides, les semences sont « oculées », c’est-à-dire infectées artificiellement.
Image: Lutte contre le fusarium avec des fongicides
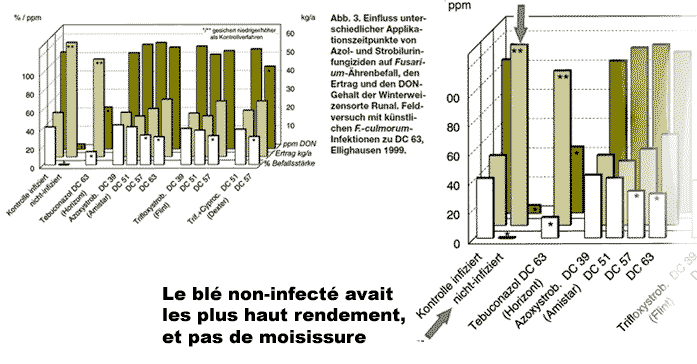
Les forêts des colonnes statistiques peuvent être intimidantes pour les non initiés ä la statistique.
Mais ils révèlent aussi des scoops embarrassants : Le blé non infecté n’a pas moisi et a eu le meilleur rendement. Mieux que le blé infecté et traité avec le meilleur fongicide. Il s’agit d’un Azole, dont le plus vendu vient d’être interdit par l’UE car il est soupçonné d’être cancérigène. Les fongicides moins dangereux, les strobulines et autres ne présentent aucun effet protecteur contre les moisissures.
Est-ce la preuve de l’effet protecteur du fongicide Azole? Seulement si le paysans trempaient les graines de blé dans une sauce de moisissure avant de semer.
Bien entendu, la science interdit le transfert de résultats de pesticides provenant de plantes artificiellement infectées sur des plantes non infectées. Parce sans une telle infestation l’effet protecteur des fongicides est trop faible pour une preuve scientifique (statistiquement significative).
L’effet des fongicides Azole sur les céréales non infectées artificiellement n’a pratiquement jamais été mesuré. Ce qui n’étonne pas : La littérature scientifique avertit que les fongicides peuvent provoquer des moisissures. (Et les herbicides arrêtent la croissance du maïs pendant environ un mois).
Les expériences fongicides non oculées de la recherche agricole sont limitées à des endroits extrêmes (humides-froids-montagnards) en dehors des zones agricole, l’infestation par la moisissure des neiges (non toxique) suggèrent des visions d’horreur à la hollywood.
L’industrie propage l’utilisation de jusqu’à quatre fongicides dans le blé par an. Ils suggèrent des augmentations «pertinentes» du rendement, mais ils évitent le mot «significatif», c’est-à-dire scientifiquement prouvé.
Conflit d’intérêts – le persiflage de la science
Les succès prétendument scientifiquement des fongicides dans la recherche de l’OFAG reposent sur des conclusions inadmissibles. La prétention d’un succès sur la base de manipulations et d’interprétations méthodologiques erronés est non seulement scientifiquement interdite, mais aussi juridiquement.
Les preuves d’efficacité des pesticides dans les documents de licence sont secrètes. Seuls les résumés peuvent être consultés, ce qui évite que les erreurs de méthodologie puissent être reconnues. (2)
Quiconque prétend la nécessité d’un taux de poisons probablement cancerogene excessif dans les aliments incite délibérément à ce que une personne sur deux sera atteinte d’un cancer.
Ces stratégies nocives savamment orchestrées sont-elles le modus operandi normal des administrations ? Non. Mais ils apparaissent de plus en plus comme une condition indispensable pour faire carrière dans les hautes sphères de l’administration.
.
.
La pire pratique professionnelle possible
Les ministères de l’agriculture légitiment l’alarmisme de leur pire practice théorique possible par des recommandations de cultivation correspondantes.
Question quiz: Pourquoi le blé, est-il cultivé après le maïs, extrêmement robuste, avec sa réputation d’épuiser le sol? Pourquoi notre aliment de base, le blé, a-t-il perdu sa position optimale et millénaire au commencement de la rotation? (Une rotation des cultures commence avec une prairie, car cette forme d’agriculture hautement naturelle remédie tous les déséquilibres et dégâts).
Les subventions sont conçues de telle manière que les agriculteurs gagnent plus avec le maïs fourrager avant le blé que l’inverse? Le statut du consommateur est désormais derrière le bétail ?!
Grâce à des subventions « écologiques », les ministères de l’agriculture encouragent une combinaison optimisant l’accumulation de pesticides cancérigènes dans notre blé: Le semis direct au glyphosate avec ses quantités maximales de pesticides et le blé après le maïs. Et comme cela peut entraîner des moisissures dans les variétés de blé trop sensibles…, tout le blé conventionnel est traité avec des fongicides cancérigènes.
En revanche, la rotation des cultures la plus rentable a été… interdite : Le blé double, le blé semé dans le paillis du blé précédent. Dans ce cas tout travail du sol est superflue, une solution gagnante gagnante économique et écologique.
Au lieu d’éviter les problèmes de manière préventive grâce aux bonnes pratiques professionnelles, les ministères de l’agriculture favorisent une accumulation de poisons (probablement cancérogènes).
Ce principe s’applique encore plus à la seule culture arable vraiment sensible: Selon les recommandations officielles, les pommes de terre nécessitent au moins 13 traitements de fongicides, en plus des autres pesticides.
Deux poids, deux mesures
Si les preuves scientifiques démontrent qu’un pesticide est dangereux, les ministères de l’agriculture l’approuvent, voire le subventionnent.
En revanche, ils interdisent des méthodes agricoles très rentables même s’il n’existe aucune preuve scientifique qu’ils soient problématiques. Et des variétés anciennes, encore moins dangereuse.
La science et les pesticides
Les preuves de l’efficacité des pesticides
- sont soit erronées (statistiquement non significative ou méthodologiquement incorrecte, de sorte qu’elle ne peut être confirmée scientifiquement)
- ou manquantes (c’est à dire secretes), pour environ 95% des pesticides. Toutefois, la science n’accepte que les preuves publiées qui répondent à toutes les exigences de la théorie scientifique; des preuves secrètes ou des résumés ne constituant pas des preuves scientifique acceptables.
Pour presque tous les pesticides, la science ne peut pas reconnaître leur efficacité supposée.
Sans doute le plus grand tabou de notre époque.
Pour presque tous les pesticides, il n’y a pas de preuves scientifiques correctes, qui affirment leurs efficacités.
Ceci correspondent à l’absence de nécessité de ces toxins.
Une personne sur deux est ou sera atteinte d’un cancer, ce qui constitue une preuve (statistiquement hautement significative et scientifiquement) incontestable que l’exposition aux pesticides, est beaucoup trop élevée.
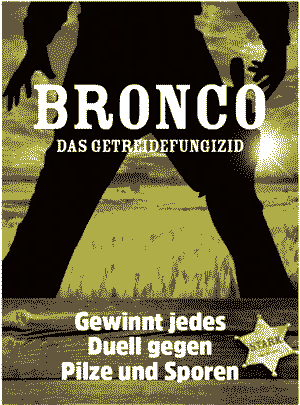
C’est ainsi qu’on vend un risque inutile de cancer
Sources:
(1) Schachermayr, G. Fried P.M. (2000): Problemkreis Fusarien und ihre Mykotoxine. Agrarforschung 7 (6), 252-257
(2) EU: (91/414/EWG) Art, 14 , 283/2013 (EG) Nr. 1107/2009 App II, Suisse: PSMV 916.161, 52, 3 g